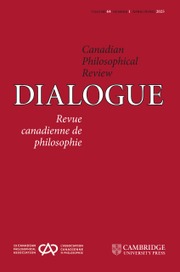Dans cet article, je présente une réflexion critique exploratoire au croisement des agentivités neurodivergentes et du livre de C.Thi Nguyen, intitulé Games: Agency As Art. Ce dernier théorise les jeux comme un art à proprement parler : plus précisément, il avance que les jeux permettent de développer l’art de l’agentivité, et ce, au même titre que le fait de pratiquer d’autres sortes d’arts comme la peinture, la musique ou la danse entraîne le développement de diverses vertus. Or, même si Nguyen louange les jeux tout au long de son livre, il parvient à une conclusion plutôt pessimiste lorsqu’il explore la possibilité de transposer les éléments de ludification (gamification) et de les intégrer à notre vie quotidienne. En effet, il soutient que ludifier son existence est dangereux et met en péril l’autonomie des personnes qui procèdent à ce transfert d’éléments du jeu à la réalité. Dans cet article, mon objectif est d’examiner si les conclusions de Nguyen au chapitre neuf de son livre, qui traite des dangers de la ludification de l’existence, sont fondées sur des présupposés capacitistes. En m’appuyant sur les philosophies et les recherches scientifiques qui abordent la neurodivergence, je démontre que la théorie de Nguyen contient effectivement des présupposés capacitistes. Or, pour bien mettre en lumière les implications de ses conclusions, j’expliquerai d’abord ce qu’est la ludification, puis je résumerai les arguments que Nguyen mobilise pour parler des dangers de la ludification de l’existence. Ensuite, je critiquerai ses conclusions de trois façons. D’abord, je montrerai que son argumentaire révèle un angle mort découlant d’une ignorance neurotypique. Puis, je solliciterai les travaux de le·a philosophe·esse Quill R.Kukla pour souligner la possibilité d’atténuer l’un des dangers de la ludification soulevés par Nguyen. Enfin, j’avancerai que Nguyen a tort d’identifier le jeu comme principal responsable des dangers liés à la ludification de l’existence, en particulier en ce qui concerne ce qu’il nomme la saisie de la valeur.
1. Qu’est-ce que la ludification ?
D’abord, il est important de mentionner que dans les huit premiers chapitres de son livre, Nguyen souligne les nombreux aspects positifs des jeux, sur le plan tant individuel que collectif. Pour ce faire, il analyse les bienfaits des jeux de société, allant des jeux « classiques »— comme Monopoly, Risk ou les échecs— à des jeux catégorisés comme plus complexes, comme Sign Footnote 1 , en passant par les jeux sportifs (comme le tennis et l’escalade) et les jeux vidéo (comme Super Mario Bros.). Son but, en ratissant le domaine des jeux de la manière la plus élargie possible, est de démontrer que les bienfaits et les vertus des jeux ne se trouvent pas seulement dans quelques jeux, mais bien dans tous les jeux. Le coeur de son livre consiste à prouver que l’agentivité est une vertu développée par la pratique de tout jeu, quelle que soit sa nature. Autrement dit, pour Nguyen, l’agentivité est un art qui s’acquiert par le jeu.
Or, au chapitre neuf, Nguyen se montre plus critique par rapport aux jeux : il décrit les dangers potentiels de la ludification de l’existence. Il définit la ludification de la manière suivante : « consider the active and intentional gamification of non-game life. [Gamification], as most people use the term, is the intentional application of various elements of game design to non-game life in order to alter motivational states. Atypical use of gamification is to increase motivation in productive behaviour » (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.200 ; je souligne). Par conséquent, ludifier son quotidien consiste à introduire intentionnellement des éléments de jeu dans une ou plusieurs sphères de sa vie, et ce, dans le but d’augmenter sa motivation à effectuer une action x ou y. Duolingo, Strava et Fitbit ou Apple Watch représentent quelques exemples paradigmatiques de ludification que Nguyen répertorie. Il s’agit d’applications ou d’appareils électroniques qui prennent des éléments de jeu afin de motiver les personnes qui les utilisent à non seulement viser, mais également atteindre un but noble et important, comme l’apprentissage (d’une langue ou d’un sujet quelconque), la santé, la productivité ou de saines habitudes de vie. Ces divers éléments de jeu peuvent prendre les formes suivantes : introduire un système de pointage, de récompenses ou, au contraire, de « pénalités » si l’objectif visé n’est pas atteint selon des conditions prédéfinies (par exemple, de temps, de vitesse ou d’une autre donnée x) ; instaurer un système de niveaux à réussir pour encourager la poursuite du but visé ; inclure diverses sortes de monnaie à accumuler afin de l’échanger contre différents pouvoirs ou avantages facilitant l’atteinte du but, etc.
1.1. Les dangers de la ludification de l’existence
Si ces applications ludiques ne semblent pas a priori menacer la volonté et l’autonomie des personnes les utilisant, Nguyen soutient que certaines caractéristiques des jeux peuvent devenir dangereuses lorsqu’elles sont intégrées dans nos vies réelles. Plus précisément, Nguyen soulève deux problèmes que peut entraîner la ludification de l’existence.
D’une part, le jeu se distingue de la vie réelle par son mode de raisonnement purement instrumental. Comme l’a si bien démontré Emmanuel Kant, l’être humain n’est jamais un moyen pour une fin, telle est la maxime du devoir kantien. Or, dans les jeux, le devoir moral n’est plus nécessaire ni requis : il y est permis d’instrumentaliser sa ou son partenaire dans le but de se rapprocher de l’objectif visé par le jeu. Nguyen écrit :
Crucially, this means that we don’t need to treat others’ interests as valuable. We need not treat them with, as the Kantians might put it, dignity and respect. We are permitted to manipulate, use, and destroy. This attitude is permissible in some games because our opponent’s ends in the game are disposable, because our opponents have consented to the struggle, and because the design of the game can convert our purely selfish attacks into a delightful struggle for our opponents. (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.192 ; je souligne)
Ainsi, il serait absolument impensable pour Kant de jouer une partie de Monopoly, car instrumentaliser chaque joueur·euse afin d’accumuler un maximum d’argent dans le but de remporter la partie est immoral. En revanche, chaque décision de la vie réelle exige des raisonnements et des délibérations beaucoup plus complexes. La plupart de nos décisions quotidiennes nécessitent une analyse sophistiquée des implications et des valeurs : peser le pour et le contre, réfléchir aux valeurs qui comptent le plus pour nous, évaluer les conséquences de nos décisions et de nos actions sur notre vie et celle d’autrui, etc. De nombreux·euses philosophe·sses moraux·les ont étudié (et continuent d’étudier) la nature des actions et les facteurs influençant les choix. Bref, le raisonnement purement instrumental présent dans le jeu ne ressemble en rien aux raisonnements complexes de la vie réelle.
D’autre part, les valeurs des agentivités alternatives que l’on revêt dans les jeux sont toujours extrêmement claires, contrairement à celles de la vie réelle. En effet, les valeurs des jeux sont faciles à suivre et données à l’avance ; les buts sont commensurables et les résultats sont facilement classifiables. Certes, toutes les réponses à nos questions sont inscrites dans le manuel d’instructions, évacuant ainsi toute possibilité de délibération plus élaborée, présente dans la vie réelle. Or, comme cela a été mentionné précédemment, les valeurs et les buts qui guident nos actions dans la vraie vie ne sont jamais donnés à l’avance et sont tout sauf clairs et précis. Par conséquent, un des arguments importants que Nguyen mobilise pour mettre en garde contre la ludification de son quotidien est le danger de transposer la saisie de la valeur (value capture) du jeu à la vie. Effectivement, les caractéristiques irrésistibles susmentionnées que procurent les jeux, à savoir la clarté absolue des valeurs et la réduction du raisonnement à sa plus simple expression, rendent tentante l’introduction de ces éléments dans notre quotidien pour saisir la valeur de la vie. La saisie de la valeur, qui est certes un concept séduisant, peut nous entraîner à croire que la vie possède un manuel d’instructions à lire et à suivre, ce qui peut éventuellement nous faire perdre de vue la complexité de l’existence, dont la valeur tient justement à cette complexité et à la couleur distincte propre à chaque humain.
À propos de la saisie de la valeur, Nguyen écrit ceci :
I’m going to step back from the term [gamification], because Iwant to focus on just one specific aspect: the motivational draw of value clarity. Consider a phenomenon, which I’ll call value capture. Value capture occurs when:
1. Our values are, at first, rich and subtle.
2. We encounter simplified (often quantified) versions of those values.
3. Those simplified versions take the place of our richer values in our reasoning and motivation.
4. Our lives get worse.
Instances of value capture abound. Value capture includes cases of explicit gamification, but it also includes effects from other sorts of measures and metrics. (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.201)
Ici, le processus en quatre étapes de la saisie des valeursFootnote 2 montre clairement le danger de la simplification de nos valeurs par la ludification de l’existence. Comme le donne à voir la citation ci-haut, Nguyen développe son concept de saisie de la valeur à partir d’un aspect séduisant que possèdent les jeux : une clarté de la valeur (value clarity) indéniable. Cette clarté des valeursFootnote 3 , transposée dans la réalité, fait planer le danger de la saisie de valeur, présent dans plusieurs situations qui dépassent le cadre des jeux et où cette volonté de saisie de la valeur est concrètement problématique. Notamment, Nguyen mentionne la possibilité de vicier la noblesse de ses buts initiaux en se laissant corrompre par la commensurabilité de ses réalisations (caractéristique provenant du jeu). Par exemple, un·e étudiant·e peut initialement fréquenter le monde universitaire en poursuivant des buts très louables comme le savoir et la sagesse, mais éventuellement perdre de vue ces valeurs pour ne se concentrer que sur les notes et les productions académiques de haute envergure, à savoir uniquement des réalisations qui sont mesurables et facilement classifiables. Ou encore, une personne peut vouloir s’inscrire sur Twitter (devenu X) au nom de vertus nobles telles que la communication et la connexion humaine, mais s’éloigner de son but initial pour ultimement ne valoriser que les « retweets » et les publications générant beaucoup de mentions « j’aime », sans jamais confirmer la véracité de ses propos (c’est-à-dire en risquant potentiellement de relayer des « fake news ») (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.201-202).
Ces deux exemples se manifestent à l’échelle individuelle, mais Nguyen donne aussi des exemples problématiques de saisie et de simplification de la valeur à l’échelle collective. En effet, il mentionne que de grandes compagnies comme Disney, Amazon, Facebook et Twitter (X) ont commencé à instaurer des systèmes de points et de récompenses chez leurs employé·es. Plus précisément, chaque employé·e peut accumuler des points selon le nombre de tâches qu’il ou elle accomplit au quotidien. Ce système de points a pour but d’augmenter la productivité et la compétitivité des employé∙es (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.200). Or, ces implantations ont eu de graves impacts sur la qualité de vie et les conditions de travail de ces dernier·ières : un climat de compétition et d’extrême production s’est installé, à un point tel que les employé·es ne prenaient plus leurs pauses-dîner, ni le temps d’aller aux toilettes, ni même les congés de maladie qui leur étaient dus, voulant à tout prix accumuler des points (Gabrielle, Reference Gabrielle2018 ; Rosenblat et Stark, Reference Rosenblat and Stark2016).
Somme toute, il est jusqu’à présent assez aisé de suivre le raisonnement de Nguyen et de posséder les mêmes intuitions préliminaires que lui quant aux dangers que peut entraîner le fait de ludifier son existence.
2. Est-ce que la ludification est toujours mauvaise ?
Or, bien que les exemples mentionnés par Nguyen soient effectivement problématiques et puissent constituer un danger dans la vie concrète, je soutiens que la ludification de l’existence n’est pas aussi mauvaise qu’il semble le laisser croire. D’ailleurs, à ce propos, Nguyen écrit en début de chapitre que ses observations à propos des dangers de la ludification de l’existence sont principalement des conclusions provisoires et que ces dernières ne proviennent pas de recherches empiriques fondéesFootnote 4 , mais prennent plutôt la forme d’hypothèses (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.190-191). Il me semble donc tout à fait possible de remettre en question les bases de ses conclusions et les fondements de ses hypothèses. Pour ce faire, je mobiliserai des études en neuropsychologie sur la neurodivergence (principalement le TDAH et le TSAFootnote 5 ) et des concepts révélant les biais capacitistes que certain·es philosophe·sses peuvent reproduire dans leurs analyses. Il me semble également pertinent de signaler que Nguyen mentionne rapidement la possibilité que la ludification soit positive (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.199), bien qu’il se positionne somme toute contre elle au sein du débatFootnote 6 .
Lors de ma lecture du chapitre neuf, j’ai ressenti un certain malaise face à ses conclusions sur la ludification. Certes, mon expérience vécue de la ludification de multiples sphères de ma propre vie ne collait pas du tout avec les dangers que soulignait Nguyen. De prime abord, j’ai tenté de suivre son analyse de manière impartiale, en laissant de côté mon expérience vécue contingenteFootnote 7 . Or, on comprend rapidement à la lecture du chapitre que, pour Nguyen, le manque de motivation— nécessitant l’incorporation d’éléments de jeu dans notre vie— relève implicitement du « vice ». En d’autres termes, il ne serait pas vertueux de recourir à des éléments de jeu fictifs (une force extrinsèque) pour susciter la motivation à l’action (supposément intrinsèque) dans notre vie réelle.
2.1. L’ignorance neurotypique avec Catala etal., Reference Catala, Faucher and Poirier2021)
C’est dans sa discussion autour de la motivation que j’ai réalisé que Nguyen avait construit son argumentaire à partir d’un point de vue neuronormatif. Selon Amandine Catala etal., la neuronormativité
[Refers] to the prevalent, neurotypical set of assumptions, norms, and practices that construes neurotypicality as the sole acceptable or superior mode of cognition, and that stigmatizes attitudes, behaviors, or actions that reflect neuroatypical modes of cognition as deviant or inferior. (Catala etal., Reference Catala, Faucher and Poirier2021, p.9016 ; je souligne)
En effet, présumer que la motivation est une force absolument intrinsèque chez l’agent·e relève de présupposés neuronormatifs. Or, plus encore, je crois que Nguyen fait preuve d’une ignorance neurotypique dans son chapitre. S’inspirant de l’ignorance blanche chez Charles Mills (Reference Mills2007 ; Reference Mills2017), Catala etal. décrivent ainsi le concept d’ignorance neurotypique :
[Members] of dominant social groups, because of their socially privileged position, will not experience nor understand the world as unjustly structured: their privilege will seem so natural and normal that it will be imperceptible and hence unquestionable (lack of self-transparency) and they will thereby misunderstand significant aspects of the social world (lack of adequate understanding of social realities). This lack of self-transparency, which concerns the subject of knowledge, might be characterized as subjective ignorance; the lack of adequate understanding of social realities, which concerns the object of knowledge, as objective ignorance (Catala Reference Catala2019). In the context of autism, neurotypical ignorance, in both its subjective and objective dimensions, is due to neuronormativity. (Catala etal., Reference Catala, Faucher and Poirier2021, p.9016-9017)
Ainsi, on peut constater que Nguyen applique un cadre neuronormatif pour conceptualiser la motivation et qu’il évoque cette dernière en termes binaires de « vices » et « vertus ». En effet, il mobilise un champ lexical vertueux en envisageant la motivation comme étant inhérente à l’individu, tandis qu’il utilise plutôt un champ lexical péjoratif lorsqu’il est question de la ludification des sphères de notre vie réelle. Certes, il fait implicitement référence à l’akrasie en citant la conception aristotélicienne du bien-être chez Thomas Hurka (Reference Hurka1996). Il emploie des phrases comme : « [self-gamification] is supposed to be a way of fixing weakness of the will » ; « [but] even intentional self-gamification can lead to a loss of autonomy, when we gamify a subtler value » ; ou encore « [it] undermines my autonomy by diverting my efforts of self-control toward a more game-like target » (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.210, 213 ; je souligne). Sa compréhension de la motivation est très neurotypique puisque la motivation dans un contexte de neurodivergence est radicalement différente.
2.2. Neurodiversité et neuropsychologie : déconstruire l’ignorance neurotypique
En effet, il a été démontré scientifiquement, grâce à de nombreux scans de cerveaux neurodivergents et à de multiples analyses cliniques comparatives entre différents échantillons de population (neurotypique et neurodivergente), que les personnes neurodivergentes (qui vivent avec un TDAH et/ou qui sont autistes) expérimentent au quotidien des difficultés réelles et considérables. Elles doivent en effet composer avec des altérations de leurs fonctions exécutives (« altered neuropsychological functioning across a variety of executive function » ; Kooij etal., Reference Kooij2019, p.17), ce qui entraîne chez elles de la difficulté à entreprendre des tâches, à organiser, à prioriser, à se concentrer et/ou à maintenir leur concentration, à transitionner entre deux tâches, etc. (Kooij etal., Reference Kooij2019, p.19). Les chercheur·euses de cette étude mentionnent également que
Regarding functional MRI (fMRI) studies, task-based and resting-state findings converge. Meta-analyses show that ADHD is associated with dysfunctions in several domain-specific frontostriatal and fronto-cerebellar neural networks. Thus a meta-analysis of 39 child and 16 adult ADHD fMRI studies concluded that in ADHD there are significant dysfunctions in multiple neuronal systems involved in higher-level cognitive functions. […] The intrinsic fronto-parietal, dorsal attentional, visual, motor and default mode networks all overlap with regions showing differential task activations during inhibition, attention, or working memory tasks in ADHD compared to controls. (Kooij etal., Reference Kooij2019, p.17 ; je souligne)
Ce passage montre très clairement que la chimie du cerveau (grey matter) chez les personnes neurodivergentes fonctionne différemment (certains systèmes neuronaux du cerveau se chevauchent et interfèrent entre eux). Dès lors, la motivation, faisant partie des fonctions exécutives, n’est pas, pour les personnes neurodivergentes, une question de « volonté intrinsèque » ou de « faiblesse de la volonté », contrairement à ce que semble avancer Nguyen. Certes, chez une personne neurotypique, la date butoir de remise d’un travail académique peut être une motivation suffisante pour se lever de sa chaise dans son salon, changer de pièce et s’installer à son bureau pour continuer la rédaction de son travail. Or, la « simple » transition entre deux tâches pour une personne neurodivergente (comme se lever du fauteuil etaller à la salle de bain, ou passer à une activité comportant une différence importante sur le plan cognitif) peut être suffisamment accablante pour déclencher le mode « mise en veille » (shutdown) et repousser la tâche indéfiniment. La motivation n’est pas suffisante ici, car le trouble neurodéveloppemental plus profond empêche la transition fluide et flexible d’une tâche à l’autre (Toplak etal., Reference Toplak, West and Stanovich2013, p.131). Étant moi-même une personne neurodivergente, je vis énormément de frustration et de honte lorsque je traverse un épisode plus difficile où il m’est impossible d’accomplir mes tâches (sur le plan tant académique que personnel ou social). Pendant ces épisodesFootnote 8 , les difficultés ne sont pas seulement reliées à mes tâches professionnelles : une tâche « facile » et « automatique » comme se brosser les dents ou se nourrir peut être tout aussi impossible à effectuer. Cela peut sembler difficile à imaginer pour une personne neurotypique, mais les chercheur·euses soulignent que plusieurs problèmes de santé peuvent survenir chez les personnes neurodivergentes : « [moreover], physical disorders and ailments may become chronic due to forgetfulness, health problems induced by a negative lifestyle, poor eating and sleeping habits, and lack of health care follow-up » (Kooij etal., Reference Kooij2019, p.20).
Après avoir analysé de manière plus scientifique le fonctionnement du cerveau neurodivergent, je souhaite maintenant mobiliser une analogie un peu plus concrète afin d’illustrer les obstacles et les risques de santé invisibles auxquels font face quotidiennement les personnes aux prises avec un trouble neurodéveloppemental, afin que ce dernier ne soit pas confondu avec de la « lâcheté » ou une « faiblesse de la volonté ». Il s’agit de la théorie des cuillères (spoon theory). Inventée par Christine Miserandino (Reference Miserandino2003), atteinte du lupus, cette théorie représente bien la négociation constante entre ladite volonté et les limitations réelles, tant physiques que psychologiques, des personnes neurodivergentesFootnote 9 . La théorie des cuillères se présente ainsi : chaque personne neurodivergente commence sa journée avec en sa possession un nombre hypothétique prédéterminé et limité de douze (12) cuillères par jourFootnote 10 . Miserandino explique qu’une cuillère représente le coût énergétique et le nombre de ressources à mobiliser pour effectuer une tâche x : chaque action coûte une cuillère. Contrairement aux personnes neurotypiques qui possèdent un nombre infini de cuillères, c’est-à-dire d’énergie, de ressources et de possibilités d’action, la nécessité de négocier chaque action a pour les personnes neurodivergentes un coût énergétique élevé entraînant des répercussions importantes sur le reste de leur journée. Par exemple, pour une personne neurotypique, la routine matinale de préparation pour le travail s’effectue de façon automatique et fluide, sans jamais avoir besoin d’aller puiser dans ses réserves de cuillères, à savoir ses ressources mentales ou énergétiques. Se réveiller, sortir du lit, prendre sa douche, manger, se brosser les dents, s’habiller, aller à la salle de bain, planifier son heure de départ et se déplacer au travail sont des tâches qui ne demandent aucun effort mental à une personne valide ou neurotypique ; c’est tout le contraire pour une personne neurodivergente : la routine matinale peut rapidement épuiser jusqu’à la moitié de la réserve quotidienne en cuillères.
Grâce à cette analogie, il est possible de mettre en lumière le fait que le problème ne réside pas dans la volonté intrinsèque d’effectuer les tâches : au contraire, les personnes neurodivergentes désirent réellement accomplir toutes les tâches et les activités prévues dans leur journée. Or, elles sont également très conscientes du nombre restreint de cuillères qu’elles possèdent et doivent choisir soigneusement au cours de leur journée. Cette tension entre la volonté d’action et les grandes difficultés d’action, tant cognitives que physiques, crée énormément de souffrance, notamment de l’anxiété, de l’autodépréciation pouvant aller jusqu’à des symptômes dépressifs, etc., chez les personnes neurodivergentes (Arwert et Sizoo, Reference Arwert and Sizoo2020 ; Cooper etal., Reference Cooper, Smith and Russell2017 ; Geffen et Forster, Reference Geffen and Forster2018).
Bref, le geste de Nguyen de plaquer une analyse neuronormative de la motivation sur la ludification de différentes sphères de sa vie et de soulever hâtivement le drapeau rouge la concernant a pour impact concret d’invalider et de stigmatiser les expériences vécues de personnes neurodivergentes, qui incorporent des éléments de jeu dans leur quotidien pour contrer les difficultés que rencontrent leurs fonctions exécutives et qui luttent intérieurement pour entreprendre une tâche ou transitionner vers une autre ou pour accomplir des actions quotidiennes « simples » ou « automatiques ». Qui plus est, utiliser des éléments de jeu dans leur quotidien peut même aider certaines personnes à économiser quelques cuillères au cours de la journée. Par conséquent, la lentille neuronormative de l’analyse de Nguyen entraîne une invalidation et une stigmatisation de la réalité des personnes neurodivergentes qui vivent réellement avec un trouble (disorder) neurodéveloppemental, bien que ce dernier soit invisible (aux yeux d’autrui). Ainsi, cette perception capacitiste de la volonté et de la motivation cause de réels torts, tant épistémiques que moraux, aux personnes neurodivergentes puisqu’elles ne sont pas crues, que leur handicap et leurs difficultés sont minimisés et que leur agentivité épistémique est remise en question ; elles subissent donc des injustices épistémiques :
In sum, pervasive yet inaccurate, neuronormative assumptions about [neurodivergent people] have significant normative implications, as these assumptions severely undermine epistemic agency for [neurodivergent] persons, i.e.,their ability to engage in basic epistemic practices like producing or transmitting knowledge. Indeed, by focusing specifically on neuronormative assumptions, norms, and practices, [neurodivergent] persons suffer a host of undue credibility and intelligibility deficits (i.e.,different types of testimonial and hermeneutical injustice), both in agential/interactional and in structural/institutional forms, in ways that mutually reinforce each other and perpetuate epistemic injustice for [neurodivergent] individuals. (Catala etal., Reference Catala, Faucher and Poirier2021, p.9021 ; je souligne)
Les injustices épistémiques et la stigmatisation envers la neurodiversité sont particulièrement prononcées, surtout en raison du fait que cette dernière n’est pas visible.
2.3. Réhabiliter la ludification dans diverses sphères de son existence
Contrairement à ce que présente Nguyen dans son chapitre neuf, la ludification de l’existence pour les personnes neurodivergentes peut être extrêmement bénéfique afin de stimuler les fonctions exécutives et l’accomplissement d’une tâche grâce à une composante extérieure et un cadre volontairement imposé. Qui plus est, les cerveaux des personnes neurodivergentes sont plus susceptibles de s’activer au contact de grands champs d’intérêt. Autrement dit, pour stimuler la mise en action chez les personnes neurodivergentes, il faut susciter leur intérêt et déclencher chez elles un état de grande concentration en éveillant leur système nerveux, qui s’active lorsque mis en contact avec leurs principaux champs d’intérêt (interested-based nervous system) (Rosqvist etal., Reference Rosqvist2023, p.3652). Étant donné que les intérêts des personnes neurodivergentes diffèrent, le potentiel de ludification est infini. C’est pourquoi il existe une très grande variété d’applications ou de logiciels à cet effet. Or, certaines caractéristiques demeurent, de manière générale, assez efficaces pour déclencher un « boost » de dopamine et la mise en action. Par exemple, la Apple Watch exemplifie bien différentes caractéristiques qui captivent l’intérêt : une vibration lorsqu’un objectif est atteint ; une interface qui distingue clairement les différents objectifs (sous forme d’anneaux) et qui utilise des couleurs agréables à regarder et attrayantes ; des animations interactives, etc. Un autre bon exemple est l’application Flora, dont le but est de faire grandir une plante avec chaque séance de concentration réussie. Cependant, chaque séance de concentration inachevée entraînera un flétrissement progressif de la plante. Flora suscite l’intérêt des personnes neurodivergentes puisqu’elle combine plusieurs caractéristiques de ludification qui déclenchent une grande production de dopamine : l’instauration d’un système de collecte de pièces dans le but « d’acheter » une grande variété de plantes à faire pousser par le biais de séances « Pomodoro » ; la menace de détérioration de la plante, ce qui motive à terminer sa séance de concentration pour empêcher la plante de se faner et lui permettre de fleurir davantage ; l’utilisation de plantes et de fleurs colorées ; une vibration pour chaque séance menée à terme. Somme toute, on peut constater, grâce à ces exemples, que ludifier son quotidien peut avoir, au contraire de ce que laisse croire Nguyen, de grands bienfaits chez les personnes neurodivergentes.
3. Atténuer la force de l’argument de Nguyen avec Quill R.Kukla
À présent, je souhaite considérer une manière supplémentaire de tempérer la position pessimiste de Nguyen concernant la ludification de l’existence. Pour ce faire, je mobiliserai le concept de messiness mis de l’avant par le·a philosophe·sse Quill R.Kukla (Reference Kukla2021). Pour Kukla, les jeux ne sont pas aussi « purs » que ne le prétend Nguyen. Certes, il n’y a rien de tel que de s’immerger absolument dans le jeu, sans être simultanément impliqué·e ou englué·e (entangled) dans sa situation matérielle, charnelle, sociale, culturelle et intersubjective. Iel avance plutôt que le concept de messiness, que je traduirai par « enchevêtrement », provient du fait que les jeux sont et restent toujours enchevêtrés dans et façonnés par trois différents contextes qui s’entremêlent, à savoir : le contexte intersubjectif, le contexte matériel et le contexte culturel (Kukla, Reference Kukla2021, p.297). Cependant, l’impossibilité d’atteindre ladite pureté de l’immersion dans le jeu (telle que présentée chez Nguyen) n’empêche en rien la possibilité du développement d’agentivités alternatives ni celle de l’existence du striving play, que je traduirai par « l’art de l’effort dans le jeu ». Autrement dit, Kukla tente de réconcilier certaines notions importantes abordées par Nguyen, comme l’art de l’effort dans le jeu (qui est une vertu noble à développer) et la fluidité agentielle, tout en contournant les lacunes qui lui semblent problématiques.
Dès lors, la raison pour laquelle le concept d’enchevêtrement est pertinent pour critiquer Nguyen est que, contrairement à ce que le philosophe prétend, être un·e joueur·euse vertueux·euse ne consiste pas à vivre une immersion absolue dans le jeu et à perdre complètement de vue la réalité ou l’un (ou plusieurs) de ces trois contextes qui sont inextricablement liés à la vie tangible. Certes, actualiser la vertu de bon·ne joueur·euse (being good sport) pour Nguyen se manifeste par l’immersion complète dans le jeu, et ce, tant en maintenant un niveau d’effort soutenu qu’en lâchant prise après coup et en laissant son ego de côté une fois le jeu terminé. Chez Kukla, la représentation vertueuse d’un·e bon∙ne joueur∙euse renvoie à la capacité de sortir du cadre du jeu à tout moment si l’un des trois contextes évoqués vient à être chamboulé. Selon ellui, peut-être les jeux permettent-ils de s’immerger ou d’être absorbé·e intensément dans le moment présent. Mais, il y aura toujours un détail dans le jeu ou dans l’environnement (spatial, social, matériel ou intersubjectif) extérieur qui ramènera le·a joueur·euse à la réalité. Plus encore, pour Kukla, c’est précisément cette capacité de passer aisément du jeu à la réalité (par l’ancrage de l’un ou plusieurs des trois contextes) qui permet réellement d’être vertueux·euse dans le jeu, tout autant que dans la réalité. Pour le dire autrement, en reprenant le cadre conceptuel de Nguyen, c’est cette fluidité agentielle de navigation entre le jeu et la réalité qui représente réellement l’action vertueuse.
Ainsi, il est aisé de transposer le concept d’enchevêtrement et la vertu de bon∙ne joueur∙euse à la vie courante. Même si nous ludifions certaines sphères de nos vies et que, momentanément, nous nous y trouvons immergé·es, il y aura toujours le contexte culturel, matériel ou intersubjectif pour nous ramener à la réalité, comme l’exprime bien Kukla dans son article. Par conséquent, il est difficile de prouver que la ludification altère notre vision des valeurs et de la vie. Rappelons l’argument de la saisie de la valeur avancé par Nguyen : « [value] capture occurs when: (1) our values are, at first, rich and subtle; (2) we encounter simplified (often quantified) versions of those values; (3) those simplified versions take the place of our richer values in our reasoning and motivation; and (4) our lives get worse » (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.201). Selon moi, le chemin argumentatif que prend Nguyen fait non seulement preuve d’un manque de charité interprétative, mais met une fois de plus en lumière une conception qui relève d’une ignorance neurotypique. Certes, je réitère que, comme l’ont bien démontré Catala etal., l’ignorance neurotypique est ancrée dans « un privilège qui semble tellement naturel et normal qu’il est imperceptible et, par conséquent, n’est jamais remis en question, entraînant un angle mort important dans la compréhension des différentes réalités sociales » (Catala etal., Reference Catala, Faucher and Poirier2021, p.9016-9017 ; je traduis).
Supposons que je décide, tout à fait consciemment, de ludifier le processus visant l’objectif noble et louable de terminer la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Pour ce faire, j’utilise une application semblable à Flora, qui comptabilise mon temps de concentration et me permet de collectionner des jetons après chaque séance de concentration, et ce, dans le but d’améliorer la floraison de ma plante. Je pourrais aussi utiliser une application qui décortique chaque étape de ma rédaction et qui m’offre une récompense personnalisée pour chaque étape franchie. Or, même si je ludifie mon processus de rédaction de diverses façons, il m’est encore tout à fait possible de passer d’un état de pleine concentration (comptabilisée dans mon application ludifiée) à ma vie complexe sans que les deux réalités soient mutuellement exclusives. Je peux également garder un oeil sur mes buts initiaux et les valeurs complexes qui m’habitent tout en recourant ponctuellement à des éléments de jeu pour m’aider à atteindre mes objectifs, qui demeurent plus difficiles à accomplir que pour une personne neurotypique. En fait, présumer que les personnes neurodivergentes qui « tombent dans le panneau de la saisie de la valeur » perdent instantanément de vue la complexité de leurs buts et de leurs valeurs dès que des éléments de jeu sont introduits dans leurs vies, relève non seulement d’une ignorance neurotypique, mais est assez réducteur et renforce les biais et les préjugés capacitistes concernant le manque de volonté et d’agentivité des personnes neurodivergentes. Comme je l’ai démontré précédemment, introduire des éléments de ludification dans plusieurs sphères de sa vie n’est ni systématiquement ni toujours mauvais.
4. Contourner la critique de Nguyen : pointer le mauvais coupable
Avant de conclure, j’aimerais soulever une dernière piste de réflexion critique que je constate chez Nguyen, lorsqu’il aborde les dangers que comporte la ludification de l’existence. Pour concrétiser sa critique, je le rappelle, il prend du recul vis-à-vis de la clarté de la valeur (value clarity) pour se tourner vers la saisie de la valeur (value capture). C’est après avoir introduit ce dernier concept que Nguyen mobilise les exemples mentionnés plus tôt de grandes compagnies, comme Amazon et Disney, qui ludifient les emplois de leurs salarié·es jusqu’à les rendre dépendant·es du « jeu » qu’est désormais leur emploi. Il évoque d’autres exemples pour expliquer le danger de vouloir saisir la valeur en soi, mais il concède aussi que le jeu n’est pas une condition nécessaire à cette saisie de la valeur. Il écrit, après avoir achevé l’élaboration de son détour argumentatif à propos de la saisie de la valeur : « [notice] that many of the forces at play here have little to do with the intentional gamification of motivation. But they can still lead to value capture » (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.205).
Bien que je comprenne l’intention de Nguyen de pointer du doigt la ludification et ses dangers de simplification extrême de sphères importantes et complexes dans nos vies, dont la sphère du travail, il me semble qu’il manque sa cible et se trompe de coupable quant au danger lié à la saisie de la valeur. En réalité, j’ai plutôt l’intuition que le vrai coupable que Nguyen tente de dénoncer est le système capitaliste dans lequel nous sommes imbriqué·es— ce système qui simplifie les valeurs et les buts à atteindre afin d’accélérer toujours davantage la production et d’accroître à tout prix la richesse d’un petit nombre d’individus. Au tout début de son livre, Nguyen écrit : « [the] designer creates, not only the world in which players will act, but the skeleton of the players’ practical agency within that world » (Nguyen, Reference Nguyen2020, p.17 ; je souligne). Dans un contexte où la relation de pouvoir entre l’employeur·e et l’employé·e est inégale, le « jeu » ne peut pas s’ancrer dans un esprit de libre arbitre chez l’employé·e : iel est contraint·e d’y jouer s’iel souhaite conserver son emploi et survivre. Ainsi, les grandes entreprises peuvent se permettre d’adopter des comportements abusifs, camouflés sous le couvert du « jeu », et ce, dans une volonté d’enrichissement. Dans leur article More than Just a Game: Ethical Issues in Gamification, Tae Wan Kim et Kevin Werbach soulèvent des enjeux importants, comme l’exploitation et la manipulation :
Exploitation and manipulation both arise from the relationship between the providers and the players. […] If the flaw in the player/provider relationship is an imbalance in the real world, such that providers are able to take advantage of players’ unique vulnerabilities, the issue is exploitation. If the problem is that providers have created an environment such that, in the game, players do not make autonomous decisions, and instead make choices serving the providers, the issue is manipulation. (Kim et Werbach, Reference Kim and Werbach2016, p.33 ; je souligne)
Lorsqu’on revoit les exemples problématiques à la lumière d’un cadre capitaliste et néolibéral, on constate que le vrai problème ne se trouve pas du côté de la population qui dépend d’un salaire, généré par un emploi, pour subvenir à ses besoins. Le vrai problème ne vient pas de ces personnes qui ont « succombé » à la ludification de leur emploi dans le but d’accumuler un pointage reflétant un rendement exemplaire, quitte à se rendre malades. Les vrais coupables sont plutôt les compagnies (comme les GAFAFootnote 11 et Disney) qui ont manipulé et exploité la vulnérabilité de leurs employé·es sous le couvert du « jeu » et qui ont instrumentalisé (weaponized) le concept de ludification de la réalité à des fins capitalistes et dans le but s’enrichir davantage. Les coupables sont ces compagnies qui ont littéralement joué avec leur pouvoir d’employabilité afin de forcer des personnes vulnérables à adopter leurs systèmes de points instaurant un climat malsain de productivité extrême. S’il semble possible de blâmer individuellement chaque employé·e ayant consenti à ce « jeu » dans une optique où « l’individu [est] entrepreneur de lui-même » (Clément, Reference Clément2020, p.145), l’idéologie néolibérale se concrétise et se sédimente ainsi. En effet, le néolibéralisme place en avant-plan l’individu et son autonomie sans limites afin d’évacuer la responsabilité qu’ont les structures sociétales et les acteur·rices à l’échelle collective. Ainsi, il devient aisé de jeter le blâme sur l’individu lorsque son « entreprise » échoue :
La fiction de l’individu néolibéral est traversée par un idéal d’autonomie, de type rationnel et calculateur. L’individu y est absolument distinct des autres, unité indivisible, dans une foule fragmentée et atomisée. Plus encore, elle lui prescrit quel homme ou quelle femme il doit être, « l’individu réussi » qu’il doit devenir. (Clément, Reference Clément2020, p.158 ; je souligne)
Bref, contrairement à Nguyen, j’estime que le coupable de l’introduction de la saisie de la valeur dans notre société n’est pas la ludification de l’existence, ni même le jeu en soi, mais plutôt l’instrumentalisation (weaponization) de la ludification à des fins vicieuses et moralement condamnables, ainsi que le font le capitalisme, l’idéologie néolibérale et l’exploitation de populations plus vulnérables par des dirigeant·es motivé·es par l’appât du gain. Par conséquent, je crois qu’il y a moyen de conserver les bienfaits de la ludification chez les personnes neurodivergentes, tout en condamnant les actions, comme celles entreprises par les compagnies susmentionnées, qui visent à atteindre la saisie de la valeur dans notre société et à réduire la complexité de l’existence à sa plus simple expression dénuée de sens.
Conclusion
Somme toute, je crois avoir exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il faudrait refuser les conclusions auxquelles Nguyen aboutit dans le chapitre neuf de son livre. Après avoir expliqué le concept de ludification, j’ai présenté l’opposition de Nguyen quant à la ludification de l’existence — le danger de la saisie de la valeur, pour le philosophe, devient trop prononcé lorsque vient le temps d’introduire des éléments de jeu dans la vraie vie. Or, après avoir mobilisé des auteur·rices de divers champs d’expertise, notamment la neuropsychologie, l’épistémologie sociale et la phénoménologie critique, je crois avoir pu mettre en lumière les présupposés capacitistes dans le discours de Nguyen. Je crois aussi avoir pu sauver la ludification, tout en conservant la juste critique que Nguyen fait du danger de saisir la valeur jusqu’à en perdre de vue la réalité. Cependant, pour ce faire, j’ai dû réajuster l’angle d’analyse de Nguyen : le problème n’est pas la ludification en elle-même, mais plutôt le fait d’instrumentaliser la ludification à des fins néolibérales d’enrichissement, de productivité extrême et de manipulation de personnes vulnérables qui dépendent d’un salaire pour pouvoir survivre dans la société actuelle.
Conflits d’intérêts
L’autrice n’en déclare aucun.